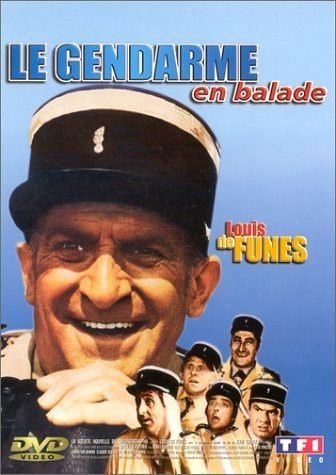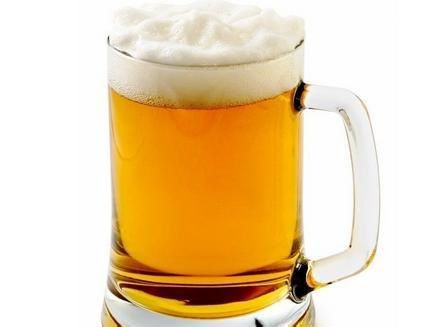Art rupestre dans les Tassilis :aux sources de l'animisme africain
Avec sa pensée empirico-logique, l'Occident parviendra-t-il un jour à déceler le sens premier et la
fonction de peintures ou de gravures jugées irrationnelles, si d'autres systèmes de pensée lui demeurent étrangers ou inaccessibles ? Si Homo sapiens sapiens, ce mammifère au cerveau non
programmé, est bien destiné à ordonner son propre désordre individuel et collectif, on doit regarder l'art, depuis les origines, il y a 40 000 ans, comme l'expression universelle de l'acceptation
de la condition humaine, comme le besoin d'organiser la vie, d'apprivoiser la mort et d'établir des correspondances entre la nature et le psychisme, en reliant le visible et l'invisible… C'est
dans cette perspective que François Soleilhavoup, qui étudie depuis plus de vingt ans les peintures et gravures tassiliennes, a publié aux éditions Transboréal Sahara. Visions d'un explorateur de
la mémoire rupestre.
Où qu'il se trouve, l'art rupestre préhistorique est porteur de messages et d'interrogations sur la place de notre espèce dans la
nature et sur les moyens de rendre supportable notre brève existence terrestre. Selon les lieux, les époques et les cultures, sa signification nous apparaît d'autant plus impénétrable qu'à la
différence des arts historiques, il est définitivement coupé du discours. En classant dans le temps et en étudiant les manifestations de cet art d'avant l'écriture, nous recherchons l'énigme de
la singularité de notre espèce, de l'unicité des origines de notre pensée symbolisante, de la diversité foisonnante des racines culturelles. Signes, symboles, figurations précises de l'homme et
de l'animal voisinent avec des représentations d'êtres chimériques ou irréels : le champ graphique de l'humanité préhistorique est immense.
L'art des « Têtes rondes »
S'il est un style de l'art saharien ancien qui résiste le plus à toute tentative d'interprétation sémiologique
et même palethnologique, c'est bien celui qu'on a pris l'habitude de qualifier ainsi de façon lapidaire, à cause de la présence de personnages peints avec une tête discoïde, munie ou non
d'appendices externes ou de décors internes géométrisés. Ces peintures anthropomorphes très particulières, souvent accompagnées d'animaux réels ou fantasmagoriques, se trouvent en réalité
circonscrites dans une aire géographique relativement réduite du Sahara central : dans la zone centrale du Tassili-n-Ajjer (Algérie), au nord-est du massif de l'Ahaggar (Hoggar), au cœur de
grands sites ruiniformes comme Séfar ou Jabbaren, dans la partie centrale et méridionale, du massif tassilien voisin de l'Akakus (Libye) et – les explorations en cours sont en train de le révéler
– dans la région de l'Aramat, aux confins nord-orientaux du Tassili, dans le sud-ouest libyen.
Bien que controversée, la position de cet art, dans la séquence chronologique générale du Sahara, est ancienne,
peut-être vers 6000 ans avant nos jours. Par ses caractères iconiques hautement spécifiques, par l'apparence négroïde d'un certain nombre de ses représentations humaines, par la théâtralité des
rituels mis en scène et l'atmosphère de magie ou de possession qui en émane, il pourrait ne refléter qu'une tradition socio-religieuse locale à l'intérieur d'une culture paléoafricaine d'essence
animiste plus largement répandue dans le centre du Sahara, au temps où les conditions climatiques étaient moins arides. D'après les superpositions de figures, Henri Lhote (À la découverte des
fresques du Tassili-1973) a distingué sept « styles » différents dans cette « école ». On devrait plutôt y voir des genres distincts qui expriment diverses thématiques dans
une même période culturelle.
Depuis deux ans, six abris sous roche ont été découverts, dont les parois portent des peintures qu'on peut
attribuer à ce chronostyle, lato sensu. Loin d'apporter des réponses, ces nouvelles images élargissent encore nos interrogations sur les finalités de leur réalisation et sur leur portée
culturelle. Cependant, dans cette région comme dans d'autres centres rupestres, plusieurs indices concordent…
L'hypothèse de pratiques « chamaniques »
Considéré comme « l'un des grands systèmes imaginés par l'esprit humain, dans diverses régions du monde,
pour donner sens aux événements et pour agir sur eux » (Michel Perrin - Que sais-je ? 1988), le chamanisme peut revêtir des aspects fort différents selon les lieux et les cultures. Il
possède cependant un trait commun, fondamental, le « commerce » entretenu avec les esprits par un personnage hors du commun, le chaman, qui, par divers moyens et techniques, par exemple
la transe, peut modifier « à volonté » ses états de conscience pour accéder au monde invisible, pour « négocier » avec les esprits et rétablir des équilibres rompus dans sa
communauté, individuellement ou collectivement. Le chaman, à la fois psychologue et thérapeute, est en même temps un homme (ou une femme) de pouvoir, au moins spirituel.
Le chamanisme repose sur une conception animiste, bipolaire, en ce qu'il considère que dans la nature, dont
l'homme n'est qu'un des éléments, tous les êtres et les choses possèdent des « âmes » et que les manifestations et le sens de ce monde-ci sont donnés par le monde-autre, celui des
esprits.
Selon cette conception, de nombreuses représentations dans le style des « Têtes rondes » exprimeraient
la relation avec le monde des esprits personnifiés ou métaphorisés par des êtres humains ou animaux, ou bien l'accès au monde invisible par le « voyage chamanique », ou encore les
rituels collectifs qui lui sont associés et même les attributs ou instruments du chaman.
Un système symbolique aux codes précis et récurrents
Dans l'abri 1 du wadi Aramat, parmi de nombreuses peintures du néolithique pastoral, ou protohistoriques
(période du cheval), un ensemble de points à l'ocre rouge, sur le plafond et sur la paroi, groupés en structures géométriques à éléments de symétrie, en lignes doubles qui pénètrent dans une
anfractuosité, ou partant de plages d'altérations naturelles de la roche, pourrait correspondre aux manifestations graphiques de relations entre ce monde-ci et l'autre, présent dans la roche ou
derrière. De tels dispositifs pariétaux existent en Europe dans des cavernes du paléolithique.
Les célèbres personnages « flottants » dans un abri de Ti-n-Tazarift, au Tassili-n-Ajjer, maintes fois
décrits et illustrant nombre de publications, peuvent évoquer la sortie du corps du chaman, sa lévitation ou « voyage » vers le monde-autre.
À Séfar, une scène complexe associe un grand animal mythique, des personnages en posture d'orants et d'autres à
tête (masque ?) bilobée, des formes circulaires munies de franges qu'on pourrait rapprocher des tambours chamaniques à peaux décorées, instruments utilisés comme moyens d'accès à la transe
et véhicule symbolique du chaman.
La fresque du grand abri de Ta-n-Zoumaïtak rassemble des caractéristiques semblables. En dépit de la diversité
des sujets qu'on y voit, animaux, humains et formes d'apparences non figuratives, l'unité stylistique de l'ensemble est remarquable. L'un des thèmes récurrents dans l'art des « Têtes
rondes », le mouflon, est ici associé à un animal chimérique, peut-être une métaphore de l'Esprit du mouflon, et à une forme ovale qui évoque, là encore, un tambour chamanique. Dans cette
hypothèse, les motifs en chevrons sur la peau résonnante, ainsi que les lanières qui pendent, sont comparables aux instruments utilisés de nos jours, ou à ceux qu'on peut voir dans les musées
d'Asie centrale, par exemple à Minusinsk.
Considérées dans leur ensemble, plusieurs fresques dans le style des « Têtes rondes » rassemblent des
mythèmes, c'est-à-dire des assemblages d'images qui peuvent revêtir des formes ou aspects divers, sans pour autant changer de signification (transformations métonymiques) – ce qui ne contredirait
pas l'idée de pratiques chamaniques dans des communautés animistes où le rêve est à la fois support et moteur de la dynamique sociale. Ainsi, vus comme un « art du rêve
institutionnalisé », ces mythèmes pourraient correspondre à une construction logique de l'irrationnel dans un système de pensée magico-religieuse et à fins thérapeutiques.
Depuis un demi-siècle, il a beaucoup été écrit sur cette période de l'art préhistorique du Sahara, encore bien
énigmatique. Une « relecture » élargie, sans cartésianisme excessif, ne pourrait cependant que nous aider à mieux comprendre l'organisation mentale, sociale, culturelle des populations
sahariennes du passé et sans doute de mieux situer leur art dans le continuum spatio-temporel des sociétés chamaniques traditionnelles…
Source Clio.fr
Le Pèlerin